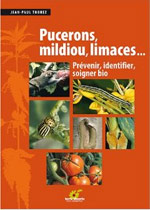Maladies et parasites de l'Hellébore
Les maladies des hellébores
La maladie des taches noires ou pourriture noire
Un micro champignon nommé Coniothyrium hellebori est responsable d'une des pathologies les plus communes sur les hellébores : la maladie des taches noires. Dévastatrice, elle se matérialise par des taches concentriques apparaissant tout d'abord sur le pourtour des feuilles les plus âgées. Elle s'étend ensuite sur toutes les parties aériennes, entraînant la décomposition des tissus et parfois même la mort de la plante.
Pour éviter la propagation de cette maladie cryptogamique, il faut agir dès l'apparition des premiers symptômes :
- Otez les feuilles infectées et détruisez-les. Surtout ne les laissez pas au sol, car les spores pourraient se propager ;
- Traitez au purin de prêle ou avec une décoction d'ail, deux produits antifongiques naturels ; pensez à traiter également les autres sujets même s'ils ne sont pas atteints.
Le mildiou
Cette maladie fongique apparaît lorsque les conditions climatiques sont humides. Le mildiou est caractérisé par des taches jaunes sur le dessus des feuilles et un feutrage blanc/grisâtre sur la face inférieure, qui finira par couvrir toutes les parties aériennes, y compris le dessus des feuilles.
Le même type de protocole que pour traiter Coniothyrium hellebori devra être appliqué. Pensez également à désherber le pied de vos hellébores afin de créer une meilleure ventilation.
Les taches foliaires
Alternaria spp. et Botrytis spp. sont les agents pathogènes responsables de l'apparition de petites taches brunes ou noires sur les feuilles, surtout en conditions humides. Il s'agit une fois de plus de maladies fongiques ! Coupez et supprimez les feuilles atteintes, arrosez seulement au pied et favorisez une bonne ventilation. Traitez avec des purins de plantes.
Bien que controversée, la bouillie bordelaise peut être utilisée en préventif contre les pathologies fongiques. Ayez alors la main légère et évitez de la pulvériser sur les plantes en fleurs pour préserver les pollinisateurs.
Les ravageurs des hellébores
Les gastéropodes
Limaces et escargots motivés par les pluies automnales et printanières se délectent des jeunes feuilles, formant des trous peu esthétiques sur le feuillage. Pour empêcher leurs déplacements vers vos hellébores, paillez leurs pieds avec des matériaux piquants comme des aiguilles de pin ou des coquilles d’huîtres et d’œufs concassées. Procédez à un ramassage manuel et libérez-les en forêt.
Les otiorhynques
Autrement connus sous le nom de 'charançons', les otiorhynques grignotent le bord des feuilles alors que leurs larves s'attaquent aux racines des hellébores, causant rapidement le dépérissement des plantes.
En prévention, placez des pièges collants autour des pieds. Pensez à la lutte biologique en introduisant des nématodes prédateurs dans la terre, ils détruiront les larves. Le purin de fougère est un bon insecticide, vous pouvez l'utiliser aussi bien en prévention qu'en traitement.
Les pucerons
Les pucerons sont des insectes piqueurs/suceurs qui s'attaquent généralement aux jeunes pousses et aux boutons floraux. Leur action a tendance à affaiblir la plante et à attirer les fourmis qui en font un élevage, mais aussi à créer un terrain favorable pour le développement de la fumagine par le biais de leur miellat qui lui sert de support.
En lutte biologique, les larves de coccinelles ou de chrysopes feront un carnage dans les populations de pucerons, mais pensez d'abord à éliminer les fourmis. Si vous n'utilisez pas cette technique, pulvérisez un mélange de savon noir et d'eau sur toutes les parties aériennes, les pucerons n'y résisteront pas longtemps !
Des conditions de culture optimales pour prévenir les pathologies et les ravageurs
Pour que vos hellébores demeurent forts et sains, il suffit simplement de leur offrir des conditions de culture idéales, ainsi, ces végétaux seront plus aptes à contrer les maladies et à ne pas se laisser envahir par les ravageurs.
L'hellébore aime pousser dans les sols bien drainés et riches, comme l'humus que l'on trouve dans leur milieu naturel. Si chez vous la terre est compacte et/ou argileuse, ajoutez du sable de rivière et du compost lors de la plantation. Vous pouvez également les installer en légère pente, toujours en les espaçant bien. Le sol ne devra jamais demeurer gorgé d'eau. Une exposition mi-ombragée lui conviendra parfaitement. Une fois l'hellébore bien installé, l'arrosage devra être parcimonieux et uniquement au pied de la plante. Dès l'automne, laissez faire la nature !
Lorsque toutes ces conditions sont respectées, les risques de développement de maladies sont limités, mais pensez bien à désinfecter vos outils si vous avez les avez utilisés sur une plante malade !
Newsletter
Abonnez-vous à notre lettre infos hebdomadaire pour recevoir chaque vendredi nos conseils pour vos plantes, le jardin, la maison... C'est gratuit !
Donnez votre avis, partagez votre expérience sur : Maladies et parasites de l'Hellébore














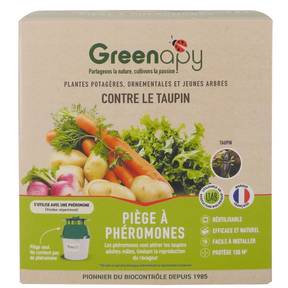
 Découvrez toutes nos offres !
Découvrez toutes nos offres !