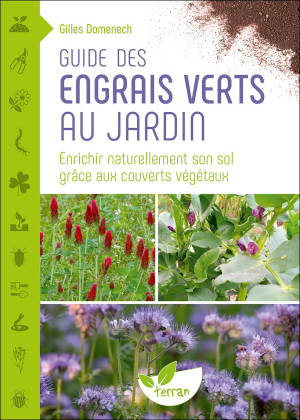Le biochar
Qu'est-ce que le biochar ?
Le biochar (contraction des termes anglais "bio charcoal") est le résidu solide et microporeux obtenu après avoir chauffé, à haute température (>350 °C), de la matière organique (résidus forestiers, déchets agricoles...) dans un environnement sans oxygène, ou très pauvre en oxygène (pyrolyse). La composition du biochar varie en fonction de sa matière première et de son mode de production, mais il est principalement composé de carbone.
Inspirées par le modèle des terres noires d'Amazonie, l'agroécologie, l'agroforesterie et la permaculture ont recours à ce « carbone noir » pour amender et fertiliser les sols très pauvres et acides.
Terra Preta : les terres noires d'Amazonie
Il s'agit de sols allant jusqu'à un mètre d’épaisseur, dans lesquels on retrouve de petites particules de charbon (de bois et autres matières organiques) et de cendres. Leur extraordinaire fertilité est imputée à la présence importante de carbone.
Quels sont les avantages du biochar ?
Fertilisation des sols
Le biochar n'est pas un fertilisant, mais il contribue à la fertilisation du sol. En effet, du fait de sa structure poreuse, il sert d'abri à de nombreux micro-organismes qui utilisent ses cavités pour se protéger des prédateurs ou pour stocker le produit de leur métabolisme. Le tout contribue à la structuration du sol (ameublissement) et à sa fertilité, les plantes ayant plus facilement accès aux nutriments. Et ce, pour longtemps : le carbone obtenu par pyrolyse est stable, c'est-à-dire qu'il ne se dégrade que très lentement.
Une réserve d'eau et de nutriments
Le biochar absorbe également l'eau (par capillarité) et retient les nutriments (capacité d'échange cationique) contenus dans le sol. Dans un second temps, il les redistribue en fonction des besoins des plantes et des micro-organismes locataires, au lieu de les laisser être lessivés.
Des électrons plus efficaces
Le biochar facilite et accélère les réactions chimiques souterraines (notamment la circulation des électrons). Il en découle une meilleure activité des micro-organismes et des bactéries fixatrices d'azote et, par conséquent, une meilleure fertilité du sol.
Réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère
Les résidus végétaux dont la décomposition naturelle serait source d'émissions de CO2 dans l'atmosphère (responsables du réchauffement climatique) sont ici transformés en « carbone noir » stable et stocké dans le sol, à très long terme.
Un piège à métaux lourds
Il semblerait que le biochar rende moins « biodisponibles », pour les plantes, les métaux lourds toxiques présents dans le sol.
Augmentation du pH des sols
Le biochar élève le pH des sols. Si cela peut être utile sur des sols acides, il convient de maitriser les apports sur les sols neutres et de les éviter sur les sols alcalins ou sur les sols portant des cultures acidophiles (plantes de terre de bruyère par exemple).
Les différentes utilisations du biochar
Le biochar peut s'utiliser comme amendement. Selon les recommandations d'utilisation de Jeff Cox* :
- Sur sol neutre : 500 g pour 1 m2 de sol (une couche de 2,5 cm d'épaisseur de biochar) à incorporer.
- Sur sol acide et dégradé : 1 kg pour 1 m2 (une couche de 5 cm d'épaisseur) à incorporer.
Il peut être également incorporé au pied des arbres fruitiers et d'ornement, des plantes potagères, au moment de la plantation, ou dans le substrat des plantes en pot.
Selon le procédé de fabrication utilisé et la nature des matières premières transformées, les biochars obtenus peuvent être différents par leur texture (plus ou moins grossière) et leur composition. Pour une utilisation « jardin et plantes », il est conseillé d'utiliser, de préférence, un biochar fin.
Le biochar peut être inoculé
Il existe aussi des biochars inoculés qui apportent des bienfaits complémentaires aux plantes. On trouve par exemple des biochars mycorhizés. Les champignons mycorhiziens stimulent la capacité des plantes à se nourrir et à se défendre. Associés au biochar, ils sont particulièrement intéressants au moment de la plantation pour une meilleure reprise et un meilleur enracinement.
Le biochar, un produit miracle ?
Malgré les promesses annoncées, le biochar a ses détracteurs. D'une part, des interrogations sont soulevées quant à la durée de rétention du carbone dans le sol, au coût financier et au coût écologique de la production du biochar à l'échelle industrielle (pollutions possibles liées à certains procédés de fabrication, à la collecte des intrants, à la distribution du produit fini, à la suppression de la matière organique en décomposition des forêts qui joue un rôle dans sa régénération...). Il convient donc d’être vigilant sur le choix du fabricant et l’origine du biochar. La matière utilisée doit être en provenance de forêts gérées durablement en France.
D'autre part, bien que certaines expériences menées en agriculture aient été très concluantes (avec une augmentation significative des rendements), d'autres semblent avoir été plus mitigées. Les mécanismes d'action du biochar dans les sols n'ont pas encore délivré tous leurs secrets. Les études se poursuivent pour affiner les connaissances sur le biochar.
*Jeff Cox est l’auteur de nombreux livres sur le jardinage, la cuisine et le vin. Il a été le rédacteur en chef de la revue Organic Gardening et collabore à la revue Horticulture, où il tient une chronique sur la science du jardinage.
Pour en savoir plus sur le biochar, vous pouvez lire "Jardiner avec le biochar" (éditions de Terran)
Newsletter
Abonnez-vous à notre lettre infos hebdomadaire pour recevoir chaque vendredi nos conseils pour vos plantes, le jardin, la maison... C'est gratuit !
Donnez votre avis, partagez votre expérience sur : Le biochar















 Découvrez toutes nos offres !
Découvrez toutes nos offres !